Actions à réaliser :
- Dégager la victime suspendue le plus rapidement possible, en sécurité
- Maintenir les membres inférieurs à l’horizontale pendant la suspension
- Allonger la victime au sol dès qu’elle est décrochée
- Appliquer la conduite à tenir selon la conscience et la respiration
- Surveiller les fonctions vitales, traiter l’hypothermie, administrer de l’oxygène si nécessaire
Qu’est-ce que le syndrome de suspension

Un mécanisme méconnu mais potentiellement mortel
Le syndrome de suspension désigne un ensemble de réactions physiopathologiques graves qui surviennent lorsqu’une personne reste immobile en position verticale, suspendue dans un harnais ou un baudrier. Bien que cette situation puisse sembler anodine, elle engage très rapidement le pronostic vital, généralement au-delà de cinq minutes de suspension sans mouvement.
Ce syndrome concerne principalement les professionnels du travail en hauteur, les pratiquants d’activités verticales comme l’escalade ou la spéléologie, ainsi que les secouristes spécialisés. Dès qu’une personne est suspendue, sans possibilité de mobiliser ses jambes, elle devient vulnérable à l’effet combiné de la gravité et de l’inactivité musculaire.
Une stagnation sanguine qui compromet la circulation centrale
Le maintien en position verticale empêche le retour veineux normal depuis les membres inférieurs vers le cœur. Le sang stagne dans les jambes, provoquant une hypotension sévère, un ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie), et une diminution de l’oxygénation cérébrale. L’évolution peut être brutale : troubles de la conscience, perte de connaissance, voire arrêt cardiaque soudain.
Des facteurs aggravants à ne pas négliger
La gravité du syndrome est accentuée par des éléments comme le froid, la fatigue, la déshydratation, ou un traumatisme associé. Il est donc impératif d’agir vite, de reconnaître les premiers signes d’alerte et de respecter les protocoles de dégagement pour limiter les risques vitaux liés à cette posture forcée.
Les causes et situations à risque en milieu professionnel ou sportif

Une problématique commune aux activités verticales
Le syndrome de suspension peut se produire dans tout contexte où une personne se retrouve suspendue sans possibilité de mobilisation active. Cette configuration est fréquente aussi bien dans le monde professionnel que dans les loisirs en milieu naturel.
Risques en environnement de travail
Les professionnels les plus exposés sont :
- Les cordistes et techniciens de maintenance sur pylônes ou structures métalliques ;
- Les ouvriers du BTP utilisant des lignes de vie ou harnais de sécurité ;
- Les opérateurs en espace confiné.
Une chute sans décrochage, une perte de conscience ou une incapacité à se mouvoir dans un harnais peut rapidement déclencher un syndrome de suspension, parfois sans être immédiatement détecté par l’entourage.
Risques dans les activités sportives et de loisir
Les disciplines concernées incluent :
- L’escalade et l’alpinisme ;
- Le canyoning et la spéléologie ;
- Les opérations de treuillage en secours montagne.
Dans ces pratiques, les phases statiques ou les accidents bloquent souvent les pratiquants en hauteur, suspendus et incapables de se dégager.
Facteurs aggravants contextuels
Certaines conditions peuvent augmenter la sévérité du syndrome :
- Isolement ou absence de communication ;
- Matériel inadapté ou mal ajusté ;
- Température extrême (chaud ou froid) ;
- Épuisement ou stress physique intense.
Les effets physiologiques et les risques mortels associés
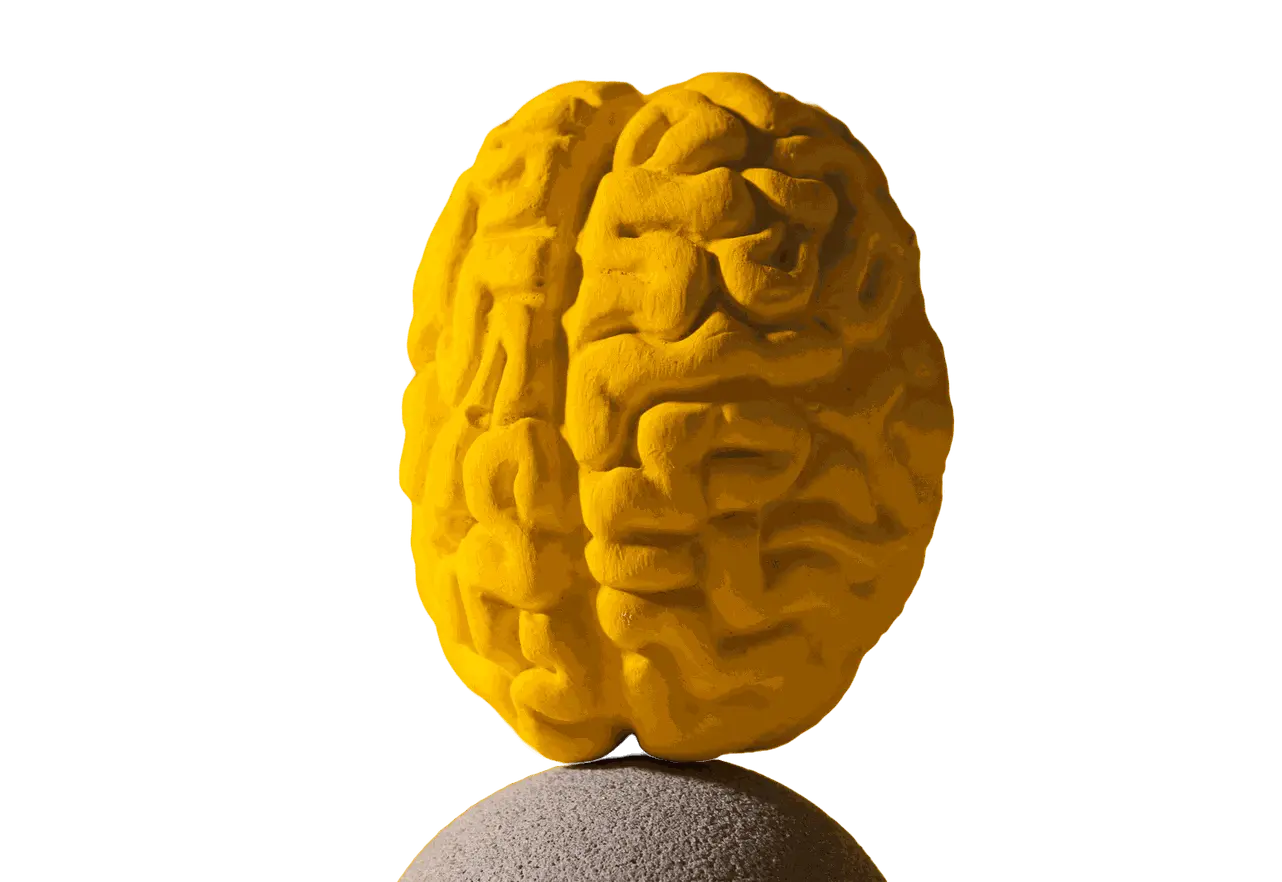
Une cascade de défaillances internes
Le syndrome de suspension ne se limite pas à une simple gêne circulatoire. Il déclenche une série de perturbations graves dans l’organisme. La compression des membres inférieurs par le harnais bloque le retour du sang vers le cœur, réduisant le volume central disponible.
Cela entraîne :
- Une hypotension brutale ;
- Une perfusion cérébrale insuffisante ;
- Des troubles de la conscience ou de l’équilibre.
Le cerveau privé d’oxygène entraîne une perte de tonus musculaire, qui favorise ensuite l'obstruction des voies respiratoires, avec risque d’asphyxie ou de vomissement.
Le risque de mort subite après dégagement
Le dégagement rapide, bien que vital, comporte lui-même des dangers. En libérant la compression des jambes, des toxines accumulées (potassium, lactates, débris musculaires) peuvent affluer vers le cœur et déclencher une défaillance multiviscérale ou un arrêt cardiaque. Ce phénomène est appelé syndrome de reperfusion.
Autres facteurs aggravants
Les complications sont plus fréquentes si d'autres éléments sont présents :
- Hypothermie liée à l’exposition prolongée ;
- Choc électrique lors d’une chute en environnement technique ;
- Intoxication ou médicament altérant les réflexes de protection.
Conduite à tenir en cas de victime suspendue

Intervenir rapidement mais sans précipitation
Dès qu’une personne est repérée suspendue dans le vide, il faut intervenir sans délai. La priorité est de réduire le temps de suspension, tout en garantissant la sécurité des intervenants. Le dégagement doit être effectué par des équipes formées (GRIMP, secours montagne) ou par des sauveteurs entraînés, avec les moyens adaptés.
Avant le décrochage : actions immédiates
Si les jambes de la victime sont accessibles, il faut tenter de les maintenir horizontales ou de les faire bouger pour favoriser le retour veineux. Si elle est consciente, on peut lui demander de contracter ou bouger ses membres inférieurs activement.
Après le décrochage : précautions vitales
Une fois la victime au sol, il est formellement contre-indiqué de la relever immédiatement. Elle doit être allongée à plat, harnais desserré si l’état le permet, puis examinée attentivement.
Deux situations doivent être immédiatement distinguées :
- Perte de connaissance : si la victime respire, on la place en PLS sauf suspicion de traumatisme. Sinon, on initie une réanimation cardiopulmonaire complète.
- Consciente : on surveille la respiration, la conscience, la température corporelle, et on ne modifie pas sa position trop rapidement pour éviter le syndrome de reperfusion.
Dans tous les cas, la médicalisation est urgente. La victime doit être suivie par des secours qualifiés et transportée vers un service hospitalier pour une surveillance prolongée.
Prise en charge d’une victime décrochée : avec ou sans perte de connaissance
Cas 1 : victime inconsciente mais respirant
On la place en position latérale de sécurité, après vérification de l’absence de traumatisme rachidien. Cela permet de maintenir les voies aériennes dégagées. La victime doit être couverte pour éviter l’hypothermie, et surveillée jusqu’à l’arrivée des secours.
Cas 2 : victime inconsciente et ne respirant pas
On débute une réanimation cardio-pulmonaire immédiatement. Si un DAE est disponible, il doit être utilisé sans délai. Ce cas est une urgence vitale absolue : toute minute perdue réduit les chances de survie.
Cas 3 : victime consciente
Elle doit être allongée à plat, jambes non surélevées. Il ne faut surtout pas la redresser ou l’asseoir trop rapidement. La surveillance porte sur :
- L’apparition de douleurs thoraciques ou abdominales ;
- Une gêne respiratoire progressive ;
- Des nausées, des sueurs, ou une désorientation.
L’administration d’oxygène est recommandée si possible. Même sans signe alarmant, la victime est considérée comme potentiellement instable jusqu’à son évaluation complète par une équipe médicale.
Conclusion
Le syndrome de suspension est une urgence trop souvent méconnue. Une personne suspendue immobile, même quelques minutes, peut rapidement évoluer vers une perte de connaissance, un arrêt cardiaque ou des lésions irréversibles. Chaque geste compte : dégagement rapide, positionnement adapté, surveillance continue et traitement des complications. Cette prise en charge spécifique doit être mieux intégrée aux formations de secourisme en milieu vertical ou industriel.
FAQ
Au-delà de 5 minutes, le risque vital augmente rapidement, surtout en position verticale.
Pour éviter une accumulation de sang dans les membres inférieurs et limiter le risque de syncope au décrochage.
Non, seulement après évaluation médicale ou stabilisation de l’état, sauf gêne respiratoire manifeste.

Oxygénothérapie
Nos kits d'oxygénothérapie de première urgence sont conçus pour intervenir en attendant l'arrivée des secours.


Syndrome de suspension : 5 gestes à adopter pour éviter une issue fatale