Actions à réaliser :
- Allonger la victime au sol dès le début de la crise pour éviter toute blessure liée à une chute.
- Protéger la tête de la victime sans entraver sa respiration, en écartant tout objet traumatisant.
- Une fois les convulsions terminées, vérifier la respiration, pratiquer la RCP si nécessaire et placer la victime en PLS.
Reconnaître une crise convulsive

Signes caractéristiques d’une crise généralisée
La crise convulsive généralisée débute de manière brutale. Elle se manifeste par une perte de connaissance, suivie de mouvements saccadés involontaires affectant tout le corps. Elle peut toucher un adulte, un enfant ou un nourrisson. Une reconnaissance rapide de cette situation permet d’agir sans délai pour protéger la victime et prévenir les complications. Avant la chute, certains signes peuvent alerter : regard fixe, bruits inhabituels, ou spasmes musculaires isolés.
Premiers réflexes à adopter dès l’apparition des symptômes
Dès les premières secondes, il est essentiel d’allonger la victime au sol pour éviter tout traumatisme lié à la chute. Il faut ensuite écarter les objets dangereux autour d’elle et dégager l’espace, notamment en éloignant les personnes présentes. Cette zone de sécurité est indispensable pour permettre à la victime de convulser sans risquer de se blesser. Aucune tentative de contention ne doit être faite : les mouvements doivent se faire sans entrave. Ces gestes simples et immédiats constituent les bases de la prévention des complications avant l’arrivée des secours.
Sécuriser la victime pendant les convulsions

Créer un environnement protecteur sans limiter les mouvements
Pendant la crise, le rôle du secouriste est de limiter les risques traumatiques sans interférer avec la crise elle-même. Il est recommandé de placer un vêtement plié ou un tissu doux sous la tête de la victime, si cela peut être fait sans risque. Cela permet d’amortir les chocs répétés contre le sol, tout en préservant les voies respiratoires dégagées.
Gérer les risques environnants sans commettre d’erreurs dangereuses
Il faut également retirer les objets à risque, comme les meubles durs, objets tranchants ou tout élément contre lequel la victime pourrait se cogner. En revanche, il est formellement interdit de mettre quoi que ce soit dans la bouche de la victime, qu’il s’agisse d’un objet, d’un tissu ou des doigts. La croyance selon laquelle une personne en crise pourrait avaler sa langue est fausse. Toute tentative de placer un objet pourrait provoquer des blessures graves ou bloquer les voies aériennes. Une fois ces précautions prises, il convient de surveiller calmement l’évolution de la crise, en veillant à ne jamais restreindre les mouvements.
Les étapes post-crise

Surveillance immédiate et sécurité des voies respiratoires
À l’arrêt des convulsions, l’urgence est d’évaluer l’état respiratoire de la victime. Il faut vérifier la présence d’une respiration spontanée. En son absence, une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) doit débuter sans délai. Si la respiration est normale, il est recommandé de placer la victime en position latérale de sécurité (PLS) pour éviter les risques d’inhalation en cas de vomissements ou de sécrétions.
Rassurer, observer, transmettre les bonnes informations
Une fois la conscience retrouvée, la victime peut être confuse ou désorientée. Le rassurer verbalement est une étape importante du rétablissement. En parallèle, il faut rechercher d’éventuelles blessures (liées à la chute ou à l’environnement), noter l’heure et la durée de la crise, et surveiller les signes retardés. Un bilan glycémique est souvent indiqué pour exclure une cause métabolique. Tous ces éléments doivent être transmis aux secours dès leur arrivée, afin d’optimiser la suite de la prise en charge. La surveillance continue est impérative jusqu’à ce que la victime retrouve pleinement ses capacités.
Particularités de la prise en charge chez le nourrisson

Précautions spécifiques liées à la fragilité physiologique
Chez le nourrisson, les principes d’intervention restent les mêmes, avec des adaptations nécessaires à sa fragilité. Il faut d’abord retirer tout vêtement superflu afin de limiter une élévation thermique, souvent déclencheur de convulsions fébriles. L’application de linges humides sur le front et la nuque, ainsi qu’une bonne aération de la pièce, sont des mesures simples mais essentielles.
Surveillance médicale renforcée et transmission précise du bilan
Comme chez l’adulte, il est interdit de limiter les mouvements. Il faut protéger la tête du bébé, sans gêner sa respiration, et éloigner tout objet dangereux. Une prise de température est indispensable dès la fin de la crise pour orienter la suite vers une cause infectieuse ou thermique. Le bilan transmis aux secours doit être clair, incluant tous les détails observés. Chez le nourrisson, les risques de complications neurologiques sont plus élevés : chaque minute compte pour enclencher une prise en charge médicale rapide. Une vigilance constante est requise jusqu’au retour total de la conscience.
Quelle attitude adopter face à une crise convulsive en milieu public ?
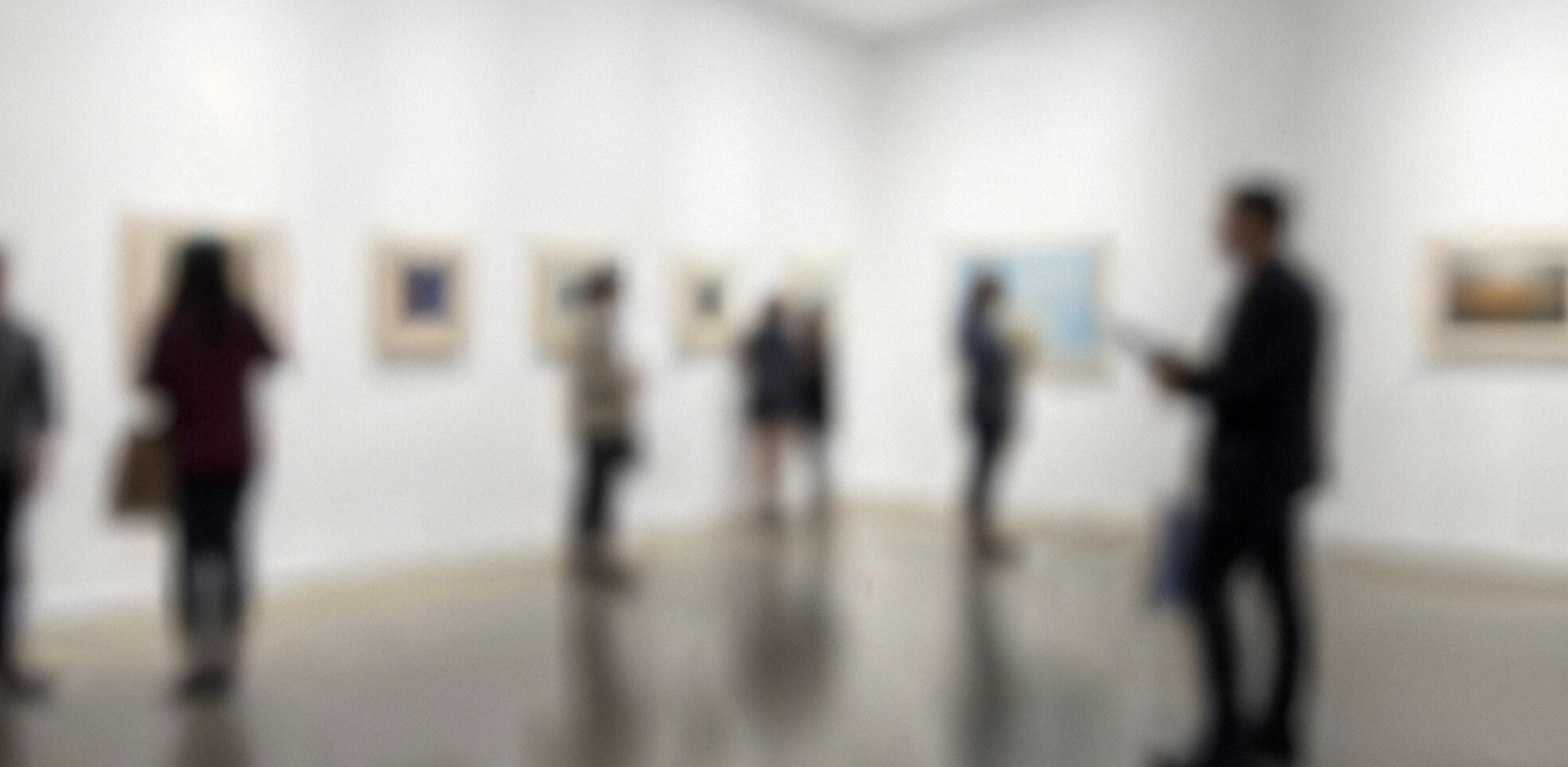
Sécurisation de la scène et protection de la victime
En lieu public, la gestion d’une crise convulsive demande à la fois de protéger la victime et de contrôler l’environnement. Il est essentiel de créer un périmètre de sécurité, en demandant aux témoins de s’éloigner. Cela limite les risques de blessures et protège la dignité de la personne, souvent exposée après la crise. L’attitude du secouriste doit rester calme et rassurante, pour éviter la panique collective.
Coordination de l’alerte et accompagnement post-crise
Une personne doit être désignée pour appeler les secours (15 ou 112), en précisant les informations utiles : type de crise, âge approximatif, durée, état post-critique. Pendant ce temps, les gestes de protection continuent : dégagement de l’environnement, pas de contention, surveillance respiratoire. Dans un cadre professionnel ou scolaire, un rapport circonstancié doit être transmis au référent sécurité ou à l’infirmier. Une fois la crise terminée, la prise en charge émotionnelle de la victime est tout aussi importante : confusion, gêne, voire honte peuvent apparaître. Un soutien humain et respectueux facilite la récupération psychologique.
Conclusion
Agir vite, sans précipitation, avec des gestes maîtrisés
Face à une crise convulsive généralisée, la réactivité doit s’accompagner de maîtrise et de méthode. Les trois étapes essentielles — reconnaître, protéger, surveiller — doivent être appliquées sans improvisation. En connaissant les gestes justes, le secouriste protège la victime, prépare l’arrivée des secours, et évite les complications. Ces réflexes, une fois intégrés, deviennent des outils essentiels pour toute personne responsable de sécurité dans les lieux publics ou professionnels.
FAQ
Non, il ne faut jamais contraindre ses mouvements. Le plus important est de protéger sa tête et de sécuriser l’environnement.
Absolument pas. Il ne faut rien placer dans sa bouche : elle ne risque pas d’avaler sa langue.
Les gestes de base sont identiques, mais il faut en plus découvrir l’enfant, le rafraîchir et surveiller sa température.

3 actions essentielles face à une crise convulsive généralisée